Annuaire Français de Relations Internationales 2009 Volume X (La documentation française Bruylant)
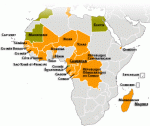 Depuis près d’une quinzaine d’années une abondante littérature porte sur les rapports entre la France, l’ancienne Puissance coloniale, et les États d’Afrique francophone. Souvent critiques à l’égard des relations que la France entretient avec ses anciennes colonies, voire avec d’autres États d’Afrique subsaharienne, les études, essentiellement destinées au grand public, ont surtout mis l’accent sur leur caractère par trop personnalisé, et le plus souvent dévoyé.
Depuis près d’une quinzaine d’années une abondante littérature porte sur les rapports entre la France, l’ancienne Puissance coloniale, et les États d’Afrique francophone. Souvent critiques à l’égard des relations que la France entretient avec ses anciennes colonies, voire avec d’autres États d’Afrique subsaharienne, les études, essentiellement destinées au grand public, ont surtout mis l’accent sur leur caractère par trop personnalisé, et le plus souvent dévoyé.
Sous le néologisme de Françafrique[1], leurs auteurs, en particulier des personnalités issues de la société civile, et souvent membres d’organisations non gouvernementales (ONG) tournées vers le Continent[2], ainsi que des journalistes, n’ont eu de cesse de dresser un réquisitoire contre les diverses pratiques tendant à pervertir les rapports franco-africains et dont la finalité première serait de pérenniser les pouvoirs en place sur le Continent. S’appuyant sur une série « d’affaires » qui ont jalonné l’histoire des relations franco-africaines depuis 1960, les pourfendeurs de la Françafrique mettent notamment en perspective les activités des multiples réseaux qui, tant en Afrique qu’en France, contribuent à maintenir, voire à tirer profit de la domination multiforme de l’ancienne Puissance coloniale. Les chroniques alimentant les faits et méfaits de la Françafrique sont le plus souvent accompagnées de galeries de portraits d’acteurs, privés et publics, appartenant à tous les secteurs professionnels.
Au-delà de certains excès ou encore des raccourcis qui l’accompagnent parfois, la critique de la Françafrique reflète à maints égards le cours chaotique trop souvent emprunté par les relations entre la France et l’Afrique, mais elle porte surtout en elle le germe du malentendu originel autour du système de coopération mis en place au moment des indépendances. En signant avec les États accédant à l’indépendance des accords de coopération dans tous les domaines, politique, militaire, économique, social et culturel, la France s’engageait certes à conforter leur souveraineté nouvellement acquise, comme en témoigne le parrainage apporté à l’admission à l’ONU, mais dans le même temps, elle conserve son emprise sur ses anciens colonisés. Du reste, les dirigeants français de l’époque ne s’en cachaient guère : à défaut d’être parvenus à préserver la Communauté prévue par la Constitution de 1958, ils se sont efforcés d’en conserver l’esprit politique par la voie conventionnelle. Cette vision transparaissait très clairement dans une lettre adressée par Michel Debré, alors Premier ministre français, le 15 juillet 1960, au futur Président de la République gabonaise, Léon M’Ba[3]. Il y était dit sans détour que la France « donne l’indépendance à condition que l’État une fois indépendant s’engage à respecter les accords de coopération signés antérieurement. Il y a deux systèmes qui entrent en vigueur simultanément : l’indépendance et les accords de coopération. L’un ne va pas sans l’autre. » Ce qui était vrai du Gabon l’a été également pour tous les États d’Afrique subsaharienne, anciennement colonisés par la France.
Ainsi le nouveau type de relations entre la France et l’Afrique avait au départ pour objectif avoué « d’institutionnaliser » la prééminence politique de l’ancienne Métropole, mais aussi et surtout sa prépondérance économique, monétaire et culturelle[4]. Par delà l’appartenance ou non à la Communauté, institutionnelle ou conventionnelle, les États africains s’accommoderont, pendant de nombreuses années, avec une intensité variable selon les périodes et les circonstances politiques d’une forte présence de l’ancien colonisateur. Ses assistants techniques seront présents en grand nombre dans les administrations africaines, y compris dans les centres de pouvoir, son armée sera stationnée en permanence en certains points stratégiques essentiels, le contrôle de la vie économique et financière lui assureront pendant longtemps un quasi monopole des débouchés commerciaux et de l’accès aux matières premières, complété par la mise en place d’une vaste zone monétaire autour du franc. Au fil des ans, cette emprise de la France se relâchera inévitablement face aux aspirations à un exercice plus effectif de la souveraineté par ses partenaires africains et à l’émergence d’une solidarité internationale plus active entre les pays en développement. Les révisions périodiques et plus ou moins profondes des accords de coopération avec la France, intervenues au cours des quatre dernières décennies, n’ont pas fondamentalement remis en cause l’essence du système mis en place en 1960[5].
I – LA PARTICULARITE DES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE
Les réformes institutionnelles intervenues du côté français tendant officiellement à normaliser les rapports avec l’Afrique (et donc à les intégrer dans le dispositif de la politique étrangère) et le désengagement en termes financier et humain (réduction de l’aide au développement ou déflation des effectifs des assistants techniques, notamment dans les secteurs administratif et éducatif) n’ont guère entamé le caractère privilégié (avec toutes les ambiguïtés que ce terme recouvre, dans le cas d’espèce) des relations entre Paris et les capitales africaines. En lieu et place des structures portant ouvertement une empreinte néocoloniale (comme par exemple le Secrétariat général aux affaires africaines et malgache, placé auprès du Président de la République), les liens avec l’Afrique, à l’exception d’une brève parenthèse (juste avant l’arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d’Estaing), ont toujours relevé d’un département ministériel spécifique.
Mais quelle que soit son appellation (Ministère de la coopération ou Ministère de la coopération et du développement), son niveau d’autonomie (ministère plein ou ministère délégué, voire secrétariat d’État rattaché au Ministère des affaires étrangères), le département en question a, dans les faits et avec des nuances, selon la personnalité de son titulaire, toujours vu son autorité réduite à la seule gestion administrative des rapports avec l’Afrique, ou à la tutelle sur les organismes d’aide, à l’image aujourd’hui de l’Agence française de développement (AFD). Pour peu que le ministre concerné veuille se départir de cette règle, érigée en dogme depuis l’avènement de la Vème République, et manifester uniquement la simple intention, sinon la volonté de conférer une dimension politique à sa mission, les partenaires africains se chargent très vite de lancer ce qu’il faut bien appeler un rappel à l’ordre, sinon une injonction, dont tiennent immédiatement compte les responsables français, et surtout le premier d’entre eux.
Le limogeage, en 1982, de Jean Pierre Cot[6] et le changement brutal de portefeuille de Jean Marie Bockel en mars 2008[7] ont illustré, de la manière la plus directe, la particularité très française que représentent les relations avec les anciennes colonies d’Afrique. Si dans le cas du premier ministre en charge de la coopération de François Mitterrand « des actes » avaient commencé à traduire un changement d’orientation de la politique africaine de la France, dans le cas du Secrétaire d’État dans le premier gouvernement de Nicolas Sarkozy, il a suffi d’une simple déclaration annonçant son intention de « signer l’acte de décès de la Françafrique » pour que la sanction tombe. Ces deux événements, survenus en l’espace de vingt cinq ans, suffisent à démontrer la pérennité d’un système fait de relations personnalisées, qui ne se limitent pas à la seule sphère politique, où s’entrecroisent des intérêts multiples et diffus, portés par des acteurs venus d’horizons divers, et agissant seuls ou en réseaux.
La singularité de la coopération franco-africaine explique en grande partie les difficultés qu’éprouvent, depuis près de cinq décennies, les responsables français à en définir la doctrine et à l’insérer dans les dispositifs de la politique extérieure. Si, périodiquement, le mot de rupture est utilisé par les responsables français pour manifester leur volonté d’introduire des changements dans la politique africaine, dans les faits il n’en a rien, ou presque rien, été. La relation avec l’Afrique a continué globalement de s’inscrire dans la continuité du Pacte colonial, sinon dans son contenu et dans les mécanismes qui le portent, du moins dans sa perception, notamment par la majorité de l’opinion publique africaine.
De 1963 (le rapport Jeanneney) à 1998, de nombreux rapports officiels ont tenté, en vain, de donner corps à une doctrine de la politique de coopération avec l’Afrique et surtout de définir de nouvelles orientations qui permettraient de l’affranchir des pesanteurs coloniales. Si les maitres mots de redéploiement de l’aide française, de dépassement du Pré carré (générique désignant les anciennes possessions coloniales d’Afrique subsaharienne) ou encore de respect de la souveraineté des partenaires, reviennent souvent dans ces documents, le poids de l’histoire a toujours fini par l’emporter. Ainsi la réforme qualifiée à l’époque d’audacieuse, entreprise sous l’égide du gouvernement de Lionel Jospin en 1998, et qui avait eu le mérite de mettre fin à la particularité institutionnelle incarnée par le Ministère de la coopération, dans le domaine administratif et politique, n’a pas eu, en fin de compte, les effets escomptés .Il en est de même du renouveau des instruments de la coopération économique avec la création de l’Agence française de développement (AFD) et de la mise en place d’un Comité interministériel à la coopération internationale et au développement (CICID).
La persistance des ambiguïtés que recouvrent les relations entre la France et l’Afrique, et les multiples intérêts qu’elles mettent enjeu, tous clivages politiques confondus, expliquent les difficultés qu’ont toujours éprouvées les gouvernements successifs à y introduire des idées de changement, qu’il s’agisse de réformer les structures de la coopération, a fortiori d’en redéfinir les orientations. Ce constat peut être fait à chacune des étapes de l’histoire politiques récente de la France. Tant les Présidents Georges Pompidou que Valéry Giscard d’Estaing, ou encore François Mitterrand, voire Jacques Chirac, se sont heurtés à des résistances provenant de milieux politiques et économiques aussi bien africains que français. A cet égard, nombre de rapports officiels sur la politique africaine de la France, demandés par le gouvernement ou d’inspiration parlementaire, ont été soit mis sous le boisseau ou non publiés (comme le rapport Gorse[8], en 1971, ou Abelin,[9], en 1975), soit « remisés » ou renvoyés à des « jours meilleurs », comme ce fut le cas du rapport d’une mission d’information parlementaire mise en place en 2007 et dont les conclusions semblent avoir divisé son président et son rapporteur (l’ancien ministre Renaud Dutreil). Remanié légèrement le rapport a été finalement rendu public le 17 décembre 2008, avec à la clé des recommandations qui, pour pertinentes qu’elles soient, ont de fortes chances de rester lettre morte.
Les oppositions à toute idée de réformer le dispositif institutionnel en charge de la politique africaine ont été illustrées, jusqu’à la caricature, par la levée de boucliers qu’a toujours suscitée, surtout du côté africain, la seule perspective d’une suppression du département ministériel en charge de la coopération.[10], ou encore de la « cellule africaine » auprès du Chef de l’État français. En réalité, cinquante ans après les indépendances africaines, l’existence d’un ministère de la coopération (quel que soit son niveau dans la hiérarchie gouvernementale), et la présence d’un conseiller Afrique à l’Elysée pérennisent d’une certaine manière l’ancien Ministère de la France d’Outre Mer (lui-même héritier du Ministère des Colonies) et la fonction de Secrétaire général de la Présidence de la République, chargé des affaires africaines et malgache, longtemps occupée par Jacques Foccart qui symbolisait la vision « impériale » et très personnalisée des relations entre la France et l’Afrique.
Alors que la nouvelle donne internationale intervenue au début des années 90, et la contestation politique qui s’est répandue en Afrique, traduite, entre autres, par la tenue de Conférences Nationales (dès février 1990, au Benin) qui ont prôné des changements radicaux, auraient pu convaincre les autorités françaises d’opter pour une rupture dans les rapports avec l’Afrique, il n’en fut rien. Il y eut, encore une fois, des atermoiements et des hésitations, qui ont illustrés par le discours que le Président François Mitterrand a prononcé, le 20 juin à La Baule, lors du XVIème Sommet des Chefs d’État de France et d’Afrique.
A cette occasion, le Chef de l’État français a certes incité ses pairs africains à s’engager sur le chemin de la démocratie, allant même jusqu’à affirmer que la « France liera tout effort de contribution aux efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté ». Mais outre le fait que le Président fût amené ensuite à tempérer ses propos, notamment au Sommet de la Francophonie à Paris, en 1991, les actes qu’il a posés au cours des dernières années de son second mandat ont clairement montré qu’il ne s’était guère départi d’une trajectoire qui s’inscrivait dans la continuité de la politique africaine de la France inaugurée en 1960.
A La Baule, comme depuis son accession au pouvoir en 1981 (et de ce point de vue le limogeage de Jean Pierre Cot en porte témoignage), François Mitterrand a surtout eu le souci de préserver un héritage, qu’à ses yeux l’histoire avait forgé, et qui conditionne aussi la place de la France[11]. Le peu d’impact qu’a donc eu le discours de La Baule sur les orientations de la politique africaine de la France n’est pas sans rappeler le caractère mystificateur du discours de Brazzaville du général de Gaulle, en 1944, qui, à en croire ses zélateurs, a impulsé l’émancipation politique de l’Empire français.
Peut-on pour autant dire que le discours de La Baule n’a eu aucun effet sur les relations entre la France et l’Afrique. Assurément non. A défaut d’avoir provoqué des remises en cause dans ce domaine, les propos de François Mitterrand ont conforté les revendications démocratiques portées par les oppositions africaines. Pour se convaincre de la charge symbolique qu’a revêtue le discours de La Baule, il suffit de relever les critiques que lui assènent, près de vingt ans après, les tenants de la Françafrique qui lui font porter aujourd’hui encore la responsabilité des malheurs du Continent.
Les réformes institutionnelles, intervenues en 1998 et évoquées précédemment, s’inscrivent dans la dynamique de ce discours et ont nourri le principe « ni ingérence, ni indifférence », que le Premier ministre de cohabitation, Lionel Jospin, a voulu appliquer dans les rapports avec l’Afrique. C’est en se fondant sur cette règle que le Premier ministre s’est opposé, à deux reprises, au Président Chirac, à propos de l’attitude à adopter au Congo, en juin 1997, et surtout en Côte d’Ivoire, en décembre 1999. A ce sujet, Lionel Jospin avait refusé de faire intervenir l’armée française, en réaction au coup d’État contre le Président Konan Bédié, que souhaitait Jacques Chirac. Tout au plus se sont-ils entendus sur une « exfiltration » par l’armée française stationnée en Côte d’Ivoire du Président déchu.
Exceptée cette parenthèse, confirmée par le renforcement des mécanismes de coopération, dans le sens d’une plus grande transparence, le contrôle de la politique africaine de la France n’a pas fondamentalement changé, comme en a témoigné la tenue régulière (tous les deux ans) des grands messes de la Conférence France Afrique, dont la seule « vertu » est d’affirmer le caractère très personnalisé et inévitablement dévoyé des rapports avec les anciennes colonies d’Afrique subsaharienne. Au nom du domaine réservé, de 1997 à 2002, et dans la pure tradition « gaullienne » jusqu’à la fin de son mandat en 2007, Jacques Chirac a agi en garant imperturbable de la relation particulière entre l’Elysée et les Chefs d’État africains[12]. C’est avec le soutien implicite de la France que de nombreux dirigeants africains sont parvenus à rogner sur les acquis démocratiques de ces dernières années (comme par exemple la limitation du nombre de mandats présidentiels) et asseoir de nouveau leur emprise personnelle sur la vie politique de leur pays.
II – L’INTERVENTIONISME FRANÇAIS ET LE SOUTIEN AUX REGIMES EN PLACE
De nos jours encore, la consécration politique du Ministère des affaires étrangères, et le regroupement auprès des postes diplomatiques des activités de coopération technique, sous l’autorité des ambassadeurs, sont loin d’avoir mis fin à la dispersion des centres de décision dans les relations avec l’Afrique subsaharienne. Une fois encore, on est tenté de dire que la volonté de maintenir le caractère fortement personnalisé des rapports existant au niveau des Chefs d’État, a toujours pris le dessus sur les efforts déployés pour témoigner de l’efficacité de l’aide au développement et en justifier le bien fondé pour les populations. De là à réduire la coopération française à un instrument avant tout destiné à protéger les pouvoirs en place (souvent en mal de légitimité), voire à les pérenniser, il n’y a qu’un pas que les opinions publiques africaines ont le plus souvent franchi. Cette vision des relations franco-africaines, surtout partagée par les jeunes générations, est confortée par les soutiens sans faille et multiples dont ont bénéficié de la part de la France des régimes impopulaires qui ont érigé l’arbitraire en mode de gouvernement.
Cette suspicion de complicité entre la France et les pouvoirs locaux, et relayée par des organes de presse plus libres et des sociétés civiles plus organisées, voire impliquées dans les mouvements de contestation politique, est périodiquement illustrée par les slogans anti français qui parsèment les manifestations de protestation contre les résultats électoraux douteux, et avantageant toujours les Chefs d’État sortants. Que ce soit au Togo en 1998, au Gabon, cette même année, ou au Tchad, en 2002, pour ne citer que ces pays, les félicitations adressées par le Chef de l’État français au Président « réélu », après ce qu’il faut bien appeler une mascarade électorale, ont contribué à ternir davantage encore l’image de la France sur le Continent. Dans le même temps où la France « officielle » avalisait des scrutins marqués par la fraude, d’autres pays occidentaux, notamment les États-Unis et l’Allemagne, n’hésitaient pas à dénoncer des scrutins dont l’organisation et le déroulement ne répondaient à aucun des critères de régularité généralement admis.
En réalité, pendant près de trois décennies, de 1963 à 1990, au nom de la protection des intérêts de certains milieux d’affaires, et de la défense de situations de monopole, dans des secteurs stratégiques (pétrole, eau, électricité, travaux publics, transports, banques), les gouvernants français, de droite comme de gauche, ont feint d’ignorer le mode arbitraire du fonctionnement politique de ses « protégés clients ». L’argument de la stabilité de l’Afrique, conjugué à des considérations idéologiques et stratégiques (lutte contre la pénétration du communisme dans les zones d’influence occidentale, en particulier en Afrique Centrale), a été ainsi brandi pour justifier des interventions militaires dont le seul objet était de maintenir au pouvoir des dirigeants aux abois et en délicatesse avec leurs populations. A ce propos, l’ancien Ministre des Affaires étrangères, Louis de Guiringaud, déclarait dans l’hebdomadaire l’Express du 15 décembre 1979 « L’Afrique est le seul continent qui soit encore à la mesure de la France, à la portée de ses moyens. Le seul où elle puisse encore, avec cinq cents hommes changer le cours de l’histoire. »
Mises à part les interventions humanitaires décidées unilatéralement par le gouvernement français, ou menées sous l’égide des nations Unies, toutes les autres actions militaires de la France en Afrique, entre 1964 et 1997, ont obéi, à un titre ou à un autre, à des motivations politiques. Elles étaient destinées à secourir un « régime ami » ou à le remplacer par un autre plus « soumis » à Paris. De fait, et sans prendre toujours le mode caricatural de l’intervention française en Centrafrique, en 1979, où selon les propres termes de Valéry Giscard d’Estaing, « la France a déposé Bokassa »[13], l’action de la France a souvent été assimilée à une opération de police intérieure, y compris lorsqu’elle comportait un volet « protection et évacuation des Nationaux ». Ce fut notamment le cas, au Gabon, en 1990 où elle a consisté aussi bien à protéger et évacuer les Français établis dans la ville de Port Gentil, en proie à des émeutes, qu’à ramener l’ordre à Libreville où les manifestants s’en étaient pris aux bâtiments administratifs.
Les affinités personnelles avec tel ou tel dirigeant africain, les intérêts en tous genres, pas toujours honorables, les pressions de Chefs d’Etat amis (le fameux « syndicat » toujours prompt à « monter au créneau » pour solliciter une aide militaire auprès des Présidents français) ont souvent pesé à l’heure des décisions d’intervenir dans des pays où les pouvoirs étaient confrontés à des troubles intérieurs. Quels que soient les cas de figure, les autorités françaises ne se sont guère embarrassées de savoir s’il existait ou non un accord avec le ou les pays concernés et de quel type d’accord il s’agissait. En réalité l’interventionnisme français n’a jamais fait grand cas du dispositif juridique existant.
Les interventions françaises ont souvent résulté, comme l’écrivait le général Fricaud Chagnaud (revue de Défense Nationale de décembre 1997) « d’accords de défense ou de coopération militaire, largement interprétés » quand elles ne se déroulent pas « dans une semi clandestinité, comme au Rwanda dans les années 80. » Cette confusion juridique et politique est du reste largement entretenue par l’existence, à côté d’accords de défense et de simple coopération militaire, d’accords secrets dont certains vont jusqu’à garantir « l’intégrité physique » de quelques Chefs d’État et leur éventuelle évacuation en cas de troubles intérieurs[14].
La pratique des interventions jusqu’en 1997 a montré que les gouvernements français successifs ont toujours réagi au cas par cas, sans se soucier de l’existence ou non d’accords de défense, en se contentant d’apprécier discrétionnairement la gravité des situations et les risques pour les pouvoirs en place, ainsi que les conséquences que pourrait avoir une intervention, tant sur le plan intérieur que régional ou international. Cette attitude a ainsi conduit le gouvernement français à ne pas répondre, pour des raisons de simple opportunité politique à des demandes d’intervention pourtant fondées sur des accords de défense. En 1963, Paris n’avait pas jugé « opportun » de répondre à une demande d’aide du Président Youlou au Congo Brazzaville, confronté à des manifestations qui emporteront son régime.
Ce type « d’intervention par omission » se renouvellera plus tard au Niger, en dépit de l’appel du Président Hamani Diori, lancé il est vrai pendant l’intérim d’Alain Poher, en avril 1974, ainsi qu’au Tchad où François Tombalbaye sera tué lors du coup d’État militaire fomenté par le général Félix Malloum. Plus tard en Côte d’ivoire, en 2002, le gouvernement n’a répondu qu’à minima à une demande d’intervention formulée par le Président Gbagbo et fondée sur un accord de défense existant entre les deux pays. La France se contentera dans un premier temps de fournir des munitions à l’armée ivoirienne, et après l’évacuation de ses ressortissants de la zone des combats, les Forces de l’Opération Licorne, dépêchées sur place, s’en tiendront à un déploiement dans une zone tampon entre les rebelles et les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI).
La confusion juridique et politique entourant la pratique interventionniste de la France en Afrique traduit l’absence de véritable doctrine en la matière et au-delà, met en relief l’interférence de facteurs multiples dans les prises de décision concernant les relations avec le Continent africain. Depuis 1960, la problématique des interventions militaires a toujours été au cœur des débats et controverses autour de la politique africaine de la France. Cela est tellement vrai que les critiques et dérives la concernant se sont surtout focalisées sur les interventions militaires. Aujourd’hui encore, les zones d’ombre de la politique française au Rwanda, renvoient non seulement au soutien multiforme que Paris a toujours apporté au régime génocidaire du Président Habyarimana mais aussi et surtout à la forte densité des relations militaires entre les deux pays avant le génocide. D’où par ricochet, la persistance des malentendus à propos de l’opération Turquoise autorisée par le Conseil de sécurité en juin 1994 mais conduite cependant par une coalition placée sous commandement militaire français.
Rien d’étonnant dès lors que le nouveau cours que les dirigeants français ont voulu impulser à la politique africaine (après l’élection de Jacques Chirac en 1995, et pendant la période de cohabitation, avec Lionel Jospin, entre 1997 et 2002) ait surtout concerné son volet militaire. Le nouveau discours, en la matière, intègre sans nul doute le traumatisme provoqué par le génocide rwandais et les nombreuses interrogations soulevées par le rôle de l’armée française, avant et après le 6 avril 1994. En déclarant solennellement, en janvier 1997, que « la période des interventions unilatérales en Afrique était close »[15], Jacques Chirac, réagissait également à la dégradation de l’image de la France en Afrique, confondue de plus en plus avec les turpitudes des pouvoirs autoritaires que le Continent a connus tout au long des trois premières décennies d’indépendance.
Cette nouvelle orientation de la doctrine militaire, fondée sur le non interventionnisme, prend désormais appui sur les mécanismes sous-régionaux, régionaux et universels de prévention des conflits, et s’identifie à des opérations de maintien de la paix conduites par les Nations Unies et les organisations internationales africaines, dont l’OUA dans un premier temps, et l’Union Africaine ensuite.
De toute évidence, ce changement de cap prenait acte des remises en cause politiques qui, du Benin au Zaïre en passant par le Mali, le Togo et le Gabon, ont emporté les régimes de parti unique et fragilisé, sinon écarté, ceux des dirigeants les plus en cour auprès du pouvoir politique français. Ce nouveau partenariat, symbolisé du côté français par l’adoption du programme RECAMP (Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix) sera expérimenté pour la première fois en République Centrafricaine (RCA), dans le prolongement du Sommet France-Afrique de Ouagadougou (Burkina Faso), en décembre 1996. Après une médiation menée par des Chefs d’État africains et le déploiement d’une force interafricaine bénéficiant du soutien logistique de la France, l’ONU y déploiera une opération de maintien de la paix (MINURCA) qui eut le mérite de restaurer, au moins temporairement, la sécurité en RCA. Le succès d’une telle initiative franco-africaine n’avait pas pour autant empêché la participation directe du contingent français stationné en RCA à des opérations de police intérieure[16] lors des violentes manifestations qui se sont déroulées à Bangui.
Cet épisode centrafricain a été conforté en juin 1997 par la non intervention au Congo Brazzaville en proie à la guerre civile. A partir de là, et pendant toute la période de cohabitation, sous la pression de Lionel Jospin, le principe du « ni ingérence, ni indifférence » prévaudra dans les rapports avec l’Afrique. Cette ligne à laquelle le Premier Ministre arrimera la politique africaine de la France, surtout dans sa dimension militaire, conduira à ne pas intervenir lors du coup d’État en Côte d’Ivoire, le 24 décembre 1999, qui renversa le Président en place, Henri Konan Bédié.
Les événements survenus dans ce même pays, après une tentative avortée de coup d’État, le 19 septembre 2002, suivie de l’occupation par une rébellion de la moitié du territoire national vient donner l’occasion au gouvernement français de tester, de façon plus explicite, d’autant qu’il s’agissait du pays phare de l’influence française dans la région, sa nouvelle approche des relations avec l’Afrique. Rompant avec la stratégie du « ni ingérence, ni indifférence » mise en œuvre en décembre 1999, les autorités françaises ont voulu, en utilisant l’emphase diplomatique du Ministre des Affaires étrangères d’alors, Dominique de Villepin, faire de la crise ivoirienne un cas d’école de la nouvelle façon de gérer, et surtout de régler, un conflit africain sans être exposé aux habituelles critiques d’ingérence que suscite toute intervention militaire de l’ancienne Puissance coloniale[17].
Mais ce changement va très vite buter sur des considérations politiques, voire personnelles, qui ont eu pour effet de jeter la suspicion sur les intentions réelles du gouvernement français. Dans ce registre, les déclarations souvent contradictoires des responsables français, civils et militaires, sur l’attitude à adopter,[18] ne permettront pas de dénouer les fils d’une situation, déjà complexe en elle-même, et qui plus est, mettait en jeu des intérêts multiples, dans un État considéré comme l’une des « locomotives » économiques de la région ouest africaine. Par ailleurs, les liens très étroits que le personnel politique français, notamment le Président de la République, Jacques Chirac[19], a toujours entretenu avec la classe dirigeante ivoirienne, n’ont pas contribué à faciliter les choses, et à faire ainsi de l’intervention française un modèle « sui generis », dans un pays confronté à une situation inédite dans le Pré Carré, à savoir l’occupation de la moitié du territoire national par une rébellion armée défiant ouvertement le pouvoir central.
En effet, sous les apparences d’un strict respect de la légalité internationale, et d’actions diplomatiques et militaires, menées en concertation étroite avec l’ONU et les organisations africaines dont l’Union Africaine et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le gouvernement français a surtout tenté d’imposer sa solution politique dans la crise ivoirienne. Celle-ci sera entérinée par l’Accord de Linas Marcoussis, signé le 23 janvier 2003, par les représentants des principaux partis politiques ivoiriens et ceux de la rébellion répartis entre trois mouvements pour « gonfler » leur représentation, mais dont seront ostensiblement exclus le Président de la République et l’armée nationale. Au delà des interrogations juridiques qu’il pouvait inévitablement soulever[20], l’Accord de Linas Marcoussis opérait un partage du pouvoir entre un Président légal mais dépouillé de l’essentiel de ses prérogatives, et une opposition politique et armée désormais présentée comme légitime.
Dans le but d’asseoir l’autorité de l’Accord de Linas Marcoussis, le gouvernement français le fera entériner au forceps par une Conférence internationale qui s’est tenue à Paris, les 25 et 26 janvier 2003et à laquelle participaient le secrétaire général de l’ONU, de la CEDEAO et de bien d’autres institutions internationales, ainsi que pas moins d’une dizaine de Chefs d’État africain. Dans le prolongement immédiat de la Conférence de « Kléber », le Conseil de sécurité de l’ONU endossera dans sa résolution 1464 du 4 février 2003 (issue d’un projet présenté par la délégation française) l’Accord de Marcoussis, et légitimera la présence de la force française Licorne.
Les contours plutôt flous de l’intervention française en Côte d’Ivoire, tant en ce qui concerne son fondement juridique, que son lien organique avec l’ONU (la force Licorne était, bien entendu, restée sous commandement français), ont dès l’origine brouillé sa perception par l’opinion tant ivoirienne qu’africaine, et ont entretenu la plus grande confusion quant à ses motivations politiques. Les événements, parfois tragiques, qui ont jalonné la crise ivoirienne et envenimé les relations franco-ivoiriennes (bombardement d’une position militaire française à Bouaké, le 6 novembre 2004 et tirs meurtriers de l’armée française contre de jeunes manifestants massés devant l’Hôtel Ivoire à Abidjan, trois jours plus tard) ont donné une tournure très particulière à l’intervention française. Ce sentiment a été conforté par l’attitude hostile au pouvoir ivoirien en place qu’ont reflété les nombreuses résolutions adoptées au Conseil de sécurité, notamment en 2005 (Résolution 1633) et 2006 (Résolution 1721), à l’initiative de la France.
Les ambigüités de l’intervention française en Côte d’Ivoire et les malentendus qui l’ont entourée ont sans conteste pesé dans l’effet d’annonce du nouveau Président français, Nicolas Sarkozy[21], de marquer une rupture dans les relations franco-africaines. Les retombées négatives en Afrique de ce qu’il faut bien appeler un fiasco diplomatique français en Côte d’Ivoire ne sont pas étrangers à la décision rendue publique, en Afrique du Sud (ce qui est en soi un symbole) par le Président Sarkozy de remettre à plat tout le dispositif militaire en Afrique (avec la suppression de certaines bases permanentes) et de renégocier les accords de défense signés pour la plupart d’entre eux, au lendemain des indépendances.
Même si les événements survenus au Tchad, en février 2008, et le soutien logistique apporté par l’armée française à la garde présidentielle d’Idriss Déby appellent à la prudence, il est incontestable qu’en matière de relations militaires, il y a désormais un avant et un après Côte d’Ivoire. Il reste que l’Exécutif français, aujourd’hui comme hier, ne peut ignorer les états d’âme d’une armée qui, en Afrique, histoire coloniale oblige, s’est toujours considérée comme un acteur ayant son mot à dire dans les décisions des autorités politiques la concernant.
III – L’IRRESISTIBLE DECLIN DE LA FRANCE EN AFRIQUE
Si pendant très longtemps, et récemment encore avec la politique de « coups de semonce diplomatique » inaugurée en Centrafrique et au Tchad contre les oppositions armées aux pouvoirs en place à Bangui et à Ndjamena, les critiques contre la politique africaine de la France se sont focalisées sur les interventions militaires, elles n’épargnent pas désormais d’autres volets comme ceux de l’immigration ou de l’aide au développement. Les reproches, dont certains ressortissent davantage du dépit que de l’hostilité, ont d’autant plus d’échos et d’incidences sur la perception et l’influence de la France en Afrique que cette dernière a connu des changements avec la fin de la guerre froide et la mondialisation.
On peut sans doute disserter sur le cheminement parfois chaotique de la vie politique sur le Continent, sur le fossé séparant les discours récurrents sur la démocratie (dont les principes sont affirmés dans les constitutions) et la perpétuation de pratiques autoritaires, les avancées sur le terrain du pluralisme et de l’exercice effectif des libertés sont devenus petit à petit une réalité. Dans ce nouvel environnement politique, caractérisé par l’émergence d’opinions publiques (sous l’effet d’une consécration de la liberté de la presse) les interventions militaires extérieures pour assurer la survie de régimes aux abois, tout comme une politique d’immigration discriminatoire, et une aide au développement de moins en moins « visible », ont eu pour effet d’écorner le regard porté sur la France.
C’est du côté des jeunes générations qui n’ont pas fréquenté, comme leurs ainés, les universités françaises, ou côtoyé dans leur carrière professionnelle des Français de leur âge, et qui n’ont souvent de la France que les images véhiculées par les chaines de télévision auxquelles ils ont aujourd’hui accès, rapportant, entre autres, des images d’expulsions, menottes aux mains, de « sans papiers » africains, que les malentendus sont les plus profonds. Longtemps soupçonnée de pérenniser des régimes dont les pratiques politiques sont de plus en plus impopulaires ou encore de protéger ses intérêts économiques, la France fait de plus en plus face aux accusations de discrimination à l’encontre des populations immigrées, notamment africaines. Il est indéniable que les scènes de violence qui se sont produites lors de l’expulsion par la police française des « sans papiers » occupant l’Eglise Saint Bernard, en 1996[22], ont eu un effet désastreux sur l’image de la France en Afrique.
Si les critiques de la Françafrique, expression d’un néocolonialisme plus difficile à cerner, et donc à combattre, sont parties des milieux associatifs français, elles se sont aujourd’hui largement répandues dans les diverses couches de la population africaine, y compris les plus aisées. Elles nourrissent chez elles un sentiment de défiance, pour ne pas dire de rejet à l’égard de la politique africaine. Dans ce domaine, les mesures restrictives en matière de flux migratoires, annoncées parfois de manière brutale par les responsables politiques français en charge de ces questions, ainsi que l’accueil, souvent vexatoire, réservé aux demandeurs de visas, dans les chancelleries et consulats français installés en Afrique, ont considérablement brouillé l’image de la France en Afrique. Cette perception est exacerbée par les nombreuses informations relayées par une presse privée, écrite comme audiovisuelle, prompte à dénoncer les « pratiques néocoloniales »[23].
Même s’il faut relativiser la portée de telles réactions, et les mettre en partie sur le compte du phénomène classique d’attirance-répulsion qui a toujours prévalu dans les relations entre anciens colonisateurs et anciens colonisés, elles traduisent néanmoins un malaise réel qu’est venu aggraver ce qu’il convient d’appeler le discours de Dakar que Nicolas Sarkozy a prononcé, le 26 juillet 2007[24]. Ce qui était censé être un discours de vérité mettant les Africains face à leurs responsabilités s’est transformé en un féroce réquisitoire contre l’Africain « qui n’est pas assez entré dans l’histoire qui, depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l’idéal de vie est d’être en harmonie avec la nature… ». Tant sur la forme que sur le fond, le discours de Dakar a soulevé une profonde indignation qui, par delà les mots blessants utilisés par le Président de l’ancienne Puissance coloniale, a illustré l’étendue des malentendus accumulés depuis plusieurs décennies, ainsi que le doute qui s’est ancré chez les intellectuels africains sur les intentions réelles de la France en Afrique[25].
C’est précisément pour corriger les effets désastreux du discours de Dakar que Nicolas Sarkozy a saisi l’opportunité que lui offrait son séjour en Afrique du Sud (pays emblématique à plus d’un titre) pour réaffirmer sa volonté d’impulser un nouveau cours aux relations franco-africaines fondé sur le respect des souverainetés des Etats concernés. Comme pour mieux souligner sa détermination à changer la politique africaine, le Chef de l’État français s’est principalement référé à ce qui constitue la principale pomme de discorde entre la France et les opinions africaines, à savoir les accords « conclus au lendemain de la décolonisation, il y a près de 50 ans !»
L’électrochoc provoqué par le discours de Dakar a conduit les ambassadeurs de France en Afrique à dresser un état des lieux d’où il ressort clairement que « la France n’est plus la référence unique ni même primordiale en Afrique. Les Français ont du mal à l’admettre ».[26] Depuis lors, les ambassadeurs en poste en Afrique se sont lancés dans des opérations de reconquête de l’opinion africaine, visant à assurer une meilleure visibilité de l’aide française et à dissiper les soupçons de toute nature qui pèsent sur Paris. Parmi les multiples actions menées dans cette direction, le Ministère français des Affaires étrangères a financé des enquêtes d’opinions dans divers pays, en coopération avec des organismes locaux.[27]
Le climat de désenchantement qui, dans le meilleur des cas, prévaut dans la relation France-Afrique, et qui se nourrit immanquablement des ressentiments à l’égard des anciens colonisateurs enfouis dans la mémoire collective des peuples anciennement colonisés, imprègnent également le domaine économique. La mondialisation, avec la diversification des partenaires extérieurs et l’éventail plus large d’offres faites par des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil, ou les monarchies du Golfe, n’y est sans doute pas étrangère. Naguère, en situation de quasi monopole dans certains secteurs, comme la banque, les transports maritimes, voire le secteur pétrolier (en Afrique centrale en particulier), les entreprises françaises font désormais face à des concurrents qui, à côté de conditions financières intéressantes, les assortissent d’engagements dans d’autres secteurs que ceux dans lesquels ils investissent principalement. A titre d’exemple, Dubaï a ainsi enlevé la concession du port de Dakar, au détriment d’une entreprise française enracinée de longue date dans la capitale sénégalaise, en accompagnant son offre principale de financements, de projets d’infrastructure routière.
Si la France demeure le premier fournisseur de l’Afrique (15% du total des importations du Continent), elle est, en revanche, le second client (10% des importations africaines). Dans ce total, la part des pays anciennement colonisés (aujourd’hui membres de la zone franc) se réduit d’année en année, et ne représentait plus que 1% du commerce extérieur français, en 2006.[28] La France court donc à terme le risque d’être marginalisée sur le plan économique[29], et de voir ainsi s’éroder son influence politique, culturelle et linguistique. Il faut certainement souligner aussi dans ce relâchement des liens la volonté non avouée par les États africains de mieux asseoir leur souveraineté, et de s’affranchir de toute forme de dépendance à l’égard de l’ancien colonisateur. Cette évolution est même inscrite dans la part de plus en plus importante prise par l’Afrique dans le fonctionnement des cadres internationaux multilatéraux comme l’OMC, les Forums Asie-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique ou Amérique Latine-Afrique, pour ne citer qu’eux.
Jamais sans doute dans l’histoire des relations entre la France et l’Afrique, le doute ne s’est autant installé sur la capacité des acteurs politiques et économiques de surmonter le syndrome de la relation de dominant à dominé. Face à des pays émergents qui investissent dans des projets nécessitant des moyens financiers très importants, la France fait de plus en plus figure de partenaire, certes « historique », mais n’ayant plus les moyens de ses ambitions en Afrique. La diplomatie française continue sans doute de se faire l’avocat de l’Afrique dans les enceintes internationales, comme en témoigne son action au sein du G8, à propos de la suppression de la dette multilatérale au profit de certains pays en développement, mais dans le même temps, elle voit son aide au développement s’étioler au fil des ans, et s’éloigner irrémédiablement de l’objectif de 0,7% du PNB fixé il y a déjà quelques décennies par les Nations Unies. Il y a là autant de raisons pour l’Afrique de rechercher ailleurs des soutiens économiques et financiers et d’afficher sa solidarité avec les autres pays en développement lors des grandes négociations internationales[30].
Les relations entre l’Afrique et la France ne sont pas l’apanage des seuls diplomates, et a fortiori des politiques ou des militaires. Ces derniers sont certes présents dans tous les domaines et à tous les niveaux de rapports très denses noués au moment des indépendances et qui ont surmonté l’épreuve du temps. Il n’y a pas une semaine sans que Paris ou l’une des capitales africaines concernées, n’accueille tantôt une commission mixte, tantôt une réunion d’experts quand ce n’est pas un séminaire ou une table ronde, où selon un rituel bien rodé, l’on célèbre, par delà les mises au point ou les divergences inévitables, la qualité de la coopération franco-africaine et la nécessité d’en préserver la particularité.
La fusion entre le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère chargé de la coopération a beau avoir été enfin réalisée, les fonctionnaires de la coopération ont beau avoir été intégrés dans le corps de la diplomatie traditionnelle, la notion de pays du « Champ » a beau avoir été banni du langage officiel, rien n’y fait. La spécificité africaine continue de résister et elle a certainement de belles années devant elle. En réalité, celle-ci ne passe pas, pour l’essentiel, par les canaux diplomatiques traditionnels, ceux d’État à État qui, bien qu’impliquant un tissu institutionnel très étoffé, sont censés relever du champ de la politique étrangère de la France. Or, la relation entre la France et l’Afrique va bien au-delà. Son imbrication dans les subtilités ou les méandres de la politique intérieure française, comme de ceux de la politique africaine dans son ensemble, est à la mesure de la multiplicité et de la diversité des acteurs concernés : acteurs privés comme publics, institutionnels comme informels, civils comme militaires mais aussi visibles comme occultes.
Et l’on touche là à ce qui constitue la marque principale des rapports franco-africains, à savoir l’intérêt soutenu qu’ils soulèvent, la passion qu’ils suscitent, le secret pas toujours recommandable qui les entoure. L’histoire avec ses restes d’implantation des réseaux d’information sur lesquels la Puissance coloniale s’appuyait naguère n’est certainement pas étrangère à la part d’ombre que comportent les relations que Paris entretient avec les États africains. Ce trait fait de réalité et de fantasmes et qu’incarne une foultitude de réseaux, vrais ou supposés, demeure la marque distinctive d’un système franco-africain où se télescopent des intérêts en tout genre et où la raison d’État se confond ou converge avec des paramètres strictement privés, si ce n’est rigoureusement individuels.
Faut-il, en fin de compte, réduire la relation entre la France et l’Afrique aux critiques, aux dérives, aux malentendus et surtout aux doutes que résume bien l’expression de Françafrique. Certainement pas. Le recul avéré de la France en Afrique, le rejet que certains de ses comportements inspirent auprès d’opinions de plus en plus ouvertes sur le monde et donc sensibles aux grandes mutations qui s’y dessinent, ne peuvent faire oublier l’histoire commune que les deux partenaires ont longtemps partagée. Au delà des nécessaires adaptations que la politique de la France en Afrique doit opérer, c’est surtout le regard sur l’Afrique qui doit radicalement changer, et inversement, celui de l’Afrique sur la France, en s’adossant à l’outil exceptionnel que constitue l’usage de la langue française, et aux responsabilités qu’il fait peser sur les décideurs politiques.
Paris, décembre 2008
[1] L’expression a été utilisée pour la première fois par l’ancien Président ivoirien, Félix Houphouët Boigny, en 1959, pour appuyer son plaidoyer en faveur d’une Fédération entre la France et l’Afrique, formule qui n’a pas été finalement retenue, au moment des accessions à l’indépendance.
[2] L’Association « Survie » et son ancien président, François-Xavier Vershave, ont consacré de nombreuses publications au thème de la Françafrique. Cf aussi Plateforme citoyenne France-Afrique. Livre blanc pour une politique de la France en Afrique, responsable et transparente. L’Harmattan Paris 2007
[3] Lettre citée par GROSSER (A). La politique extérieure de la Vème République. Ed. J . Moulin, Seuil 1965, p. 74
[4] Cf ADJOVI (R). « La politique africaine de la France. » AFRI 2001 volume 2
[5] AYISSI (A) « Une perception africaine de la politique africaine de la France ». AFRI. Volume 2000 pp. 373. 38 p.
[6] En désaccord avec la politique africaine de François Mitterrand, Jean Pierre Cot, ministre délégué à la coopération et au développement, présentera sa démission le 7 décembre 1982. Son successeur, Christian Nucci, ne s’embarrassera pas de pareilles convictions, et sa gestion se terminera avec le scandale du « Carrefour du développement » et des démêlés judiciaires.
[7] Le Secrétaire d’État à la coopération a changé de portefeuille ministériel (il est passé au Secrétariat d’État à la défense nationale chargé des anciens combattants) pour avoir publiquement mis en cause la gestion des Chefs d’État d’Afrique Centrale (Gabon et Congo Brazzaville) et exprimé le souhait de signer « l’acte de décès de la Françafrique ».
[8] qui a été ministre sous le Général de Gaulle.
[9] qui a été nommé en 1974 ministre de la coopération sous Valéry Giscard d’Estaing.
[10] La suppression subite, en mars 1974, de toute structure ministérielle propre à la coopération souleva la réprobation de nombreux Chefs d’État africains, dont le Président sénégalais, Léopold Sedar Senghor. Une fois élu à la Présidence de la République, la même année, Valéry Giscard d’Estaing rétablira un Ministère plein de la coopération. Huit ans plus tôt, en 1966, la suppression de ce même ministère de la coopération au profit d’un Secrétariat d’État aux Affaires étrangères avait déjà entrainé des réactions de la part des dirigeants africains. Le Chef de l’État sénégalais, Léopold Sedar Senghor, s’était exprimé ainsi : « Cela voudrait dire peut être que nous sommes devenus pour la France des étrangers comme les autres, alors que pour nous, les Français ne sont pas des étrangers comme les autres ». (Le Monde 30 novembre 1966)
[11] Cf Mitterrand et l’Afrique. Actes du colloque organisé à Dakar les 11-12 février 1998 par le gouvernement du Sénégal et l’Institut François Mitterrand. Dakar 1999, 287 pages.
[12] L’ancien Ministre de la coopération, en 1995, Jacques Godfrain s’exprimait ainsi à l’Université Senghor au Caire : « il est impossible à quiconque de servir l’Afrique s’il n’existe aucun lien qui dépasse la rationalité ». Propos tenus le 13 avril 1999, au cours d’une conférence sur les relations franco-africaines.
[13] Propos tenus par l’ancien Président lors d’un entretien en février 1988 sur la chaine de télévision française « La Cinq ».
[14] L’existence de tels accords secrets n’est plus contestée. Paul Quilés, Président de la Mission d’information parlementaire sur le Rwanda, en fait état à plusieurs reprises et le rapport final de cette mission fait officiellement mention de cette partie « grise » de la coopération militaire entre la France et l’Afrique. Pierre Joxe, ancien Ministre de la Défense, s’exprimait ainsi à ce propos « Nous avions passé des accords de défense dont plusieurs étaient tenus secrets. Plus tard, après Chevènement, j’ai eu le plus grand mal à mettre la main sur certains qui comportaient des parties secrètes, même pour le Ministre de la défense. Le Ministère des Affaires étrangères les conservait et n’avait pas tellement envie de remuer tout cela. On n’en parlait donc pas, c’était enterré, on avait le plus grand mal à savoir en quoi consistaient vraiment nos engagements ». (cf A propos de la France. Paris Flammarion 1998, page 72.
[15] Cf SADA (H) « Le chaos en Afrique Centrale ». Défense nationale, N° 8, 1997, page 186.
[16] Lionel Jospin, alors Secrétaire général du parti socialiste français, avait, dans une conférence de presse tenue à Paris, le 6 janvier 1997, fortement critiqué l’opération des Forces françaises menée, la veille, contre un quartier de Bangui tenu par des militaires en rébellion contre le régime en place. Le futur Premier Ministre avait notamment déclaré que « l’accord de défense avec la France n’est pas un accord de police et que l’armée française ne peut être transformée en « garde présidentielle » à l’usage de Félix Ange Patassé (le Chef de l’État centrafricain) Le Monde 7 janvier 1997.
[17] Cette approche a été exposée dans une allocution prononcée par le Ministre des Affaires étrangères à l’occasion de l’ouverture du Forum de l’IHEDN sur le Continent africain, le 13 juin 2003 (Discours accessible sur le site du Ministère des Affaires étrangères).
[18] La Ministre de la Défense, Michèle Alliot Marie avait notamment qualifié la situation « d’affaire ivoiro-ivoirienne », alors que certains officiers de la force française stationnée au 43ème BIMA prônaient un engagement aux cotés des Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI).
[19] L’ancien Président de la République française avait réservé, en 1986, son premier voyage hors de France, après sa nomination comme Premier Ministre par François Mitterrand, à la Côte d’Ivoire où il est allé, selon ses propres termes, prendre conseil auprès du Président Félix Houphouët Boigny. Quatre ans plus tard, alors que le Président ivoirien faisait face à d’importantes manifestations populaires en faveur de la légalisation du multipartisme, Jacques Chirac, en visite privée à Abidjan, s’exprimait ainsi : « Pour les pays en développement, le multipartisme est une erreur politique, c’est un luxe que les pays en question qui doivent concentrer leurs efforts pour leur expansion économique… De toute façon, le multipartisme n’est pas lié à la démocratie puisqu’il y a des pays à parti unique où la démocratie s’exerce au sein de ce parti unique… » Jeune Afrique N° 1523. 12 mai 1990.
[20] Cf Weiss (P). L’opération Licorne en Côte d’Ivoire ; AFRI 2004 vol 5, pp 313-326. du Bois de Gaudusson .(J) « L’accord de Marcoussis, entre droit et politique ». Afrique contemporaine N° 206 été 2003 pp. 41-49.
[21] Discours prononcé au Cap le 28 février 2008 au cours d’une visite officielle effectuée en Afrique du Sud. (accessible sur le site du Ministère des Affaires étrangères).
[22] Le 23 août 1996, la police française évacuait sans ménagement plusieurs dizaines d’immigrés africains qui avaient occupé cette église du 18ème arrondissement de Paris. L’événement avait fait la une de la plupart des journaux télévisés d’Afrique francophone et provoqué une profonde indignation dans l’opinion. (cf BOURGI (A) « France : la honte » Jeune Afrique n° 1860 du 28 août 1996.
[23] La presse africaine, tant au Sénégal qu’au Mali ou en Mauritanie (pays dont sont en grande partie originaires les immigrés d’Afrique subsaharienne) a commenté dans des termes très vifs (rapportés par les postes diplomatiques français et repris dans les rapports d’information parlementaires) la création d’un ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, preuve selon elle que les « Africains ne sont plus les bienvenus en France ».
[24] Accessible sur le site du Ministère des Affaires étrangères.
[25] Les réactions au discours de Dakar ont donné lieu à une abondante littérature, notamment africaine. Cf BA KONARE (A) Petit précis à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy Paris. La Découverte 2008.
CHRETIEN (J.P) (sous la direction) L’Afrique de Sarkozy Paris. Karthala 2008. 204 pages.
GASSAMA (M) sous la direction. L’Afrique répond à Sarkosy – Contre le discours de Dakar. Ed. Ph. Rey 2008
L’auteur du discours de Dakar, Henri GUAINO, conseiller spécial du président Sarkozy, s’est défendu des accusations portées contre lui, dans un article publié dans divers organes de presse. Voir dans la Gazette de la presse francophone de septembre-octobre 2008 : « L’homme africain et l’histoire ».
[26] Le Monde des 27-28 avril 2008 « L’image très dégradée de la France en Afrique ».
[27] Cf « Perceptions et représentations de la coopération française par les acteurs et les décideurs au Cameroun ». Etude proposée par la Fondation Paul Ango Ela de géopolitique en Afrique Centrale (w.w.w.fpae.net). Cette étude a été inspirée par le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France au Cameroun, et soutenue par la Direction de la coopération internationale et du développement (DCID) du Ministère des Affaires étrangères et européennes à Paris.
[28] Cf HUGON (Ph.) « La politique économique de la France en Afrique. La fin des rentes coloniales ? » Politique africaine N° 105. Mars 2007
[29] La part des investissements français en Afrique ne représentait en 2004 que 1,55% du total des investissements à l’étranger. Cf Infographie parue dans le quotidien Le Monde du 14 février 2007.
[30] A cet égard, le groupe africain à l’ONU, comme dans les autres organisations du système des Nations Unies joue un rôle actif au sein des 77 qui réunit 130 pays en développement plus la Chine.
Laisser un commentaire